 En mai 1954 le camp français de Dien Bien Phu tombait sous les coups du Viet Minh, tous les combattants, officiers et soldats, étaient fait prisonniers, l’Indochine française était perdue. Les trois jeunes gens dont les lettres sont étudiées ci-dessous avaient 23 ans pour le plus âgé, 21 pour le plus jeune. Et la jeune femme à qui ils écrivaient en avait 23 ; elle se souvient très bien de son incompréhension totale : comment le gouvernement français, le général Navarre, commandant en chef, et le colonel de Castries à la tête du camp, avaient-ils pu se laisser enfermer dans une cuvette sans autre issue que par les airs, à la merci de canons inaccessibles qui leur tiraient dessus depuis les hauteurs ? C’était absurde. Les garçons, tous trois à l’âge du service militaire, tous trois fils de bonne famille et donc nantis d’un sursis universitaire, ne comprenaient pas plus.
En mai 1954 le camp français de Dien Bien Phu tombait sous les coups du Viet Minh, tous les combattants, officiers et soldats, étaient fait prisonniers, l’Indochine française était perdue. Les trois jeunes gens dont les lettres sont étudiées ci-dessous avaient 23 ans pour le plus âgé, 21 pour le plus jeune. Et la jeune femme à qui ils écrivaient en avait 23 ; elle se souvient très bien de son incompréhension totale : comment le gouvernement français, le général Navarre, commandant en chef, et le colonel de Castries à la tête du camp, avaient-ils pu se laisser enfermer dans une cuvette sans autre issue que par les airs, à la merci de canons inaccessibles qui leur tiraient dessus depuis les hauteurs ? C’était absurde. Les garçons, tous trois à l’âge du service militaire, tous trois fils de bonne famille et donc nantis d’un sursis universitaire, ne comprenaient pas plus.
Tous quatre avaient connu l’occupation nazie, les guerres de libération, Hiroshima et ils n ‘avaient en général pas grande confiance dans un monde qui ne leur avait offert que des visions de destruction et de mort ; aucun d’entre eux n’avait jamais lu Sartre, ni Beauvoir, seule la jeune fille l’avait fait et avait réussi à leur imposer Camus. Ils n’avaient que faire des philosophes. L’histoire dont ils héritaient suffisait à les persuader de l’absurdité du monde[1] : c’était donc à eux de le changer, ils n’avaient confiance en personne, mis à part leurs amis et leurs familles ; forts de leur jeunesse, ils réagissaient par la quête de la beauté et la volonté d’agir. Et voilà que l’histoire leur donnait raison : pas plus que ceux qu’avaient connus leurs parents, les dirigeants de leur époque n’étaient capables de comprendre les évènements ni d’agir avec intelligence, Dien Bien Phu en était la preuve. Les jeunes étaient seuls face au monde.
Ils vivaient dans le milieu universitaire, ignoraient les difficultés matérielles, leur avenir était à créer, avec la formation ils pensaient y parvenir ; ils pouvaient attendre et lorsqu’ils auraient trouvé leur place, ce serait le moment de réfléchir à la politique de leur pays, et d’agir, car ils se seraient donné les moyens de le faire. Sisyphe était heureux, disait Camus, pourtant son action était inutile. Pourquoi ne pas espérer que la leur ne le serait pas ? Optimisme de la jeunesse !
Leur savoir se composait de théories et de représentations, parfois de récits et de témoignages, rarement du réel ; Pierre, qui découvre au Maroc la pauvreté intellectuelle, morale et matérielle des « recrues » dont il a la charge, est affolé par son ignorance ; il la pense non partagée par Jacqueline, qui, elle, connait « les paysans du Cantal » ! Comme si trois mois de vacances annuelles permettaient de « connaître » les villageois du hameau ! Comme si les riches fermiers du Cantal, (tout est relatif), bien formés par les instituteurs de la République, étaient un bon exemple de la mentalité populaire.
Le même constat est fait par Jacques et Olivier, dans des contextes différents : officiers ou sous-officiers, ils se retrouvent responsables de garçons de leur âge, avec lesquels ils n’ont rien de commun, si ce n’est, précisément et seulement, cet âge, et ses besoins que leur éducation leur a appris à tenir à distance, chance que n’ont pas eue ceux qui sont confiés à leurs soins.
I

La première chose qui frappe à la lecture de ces lettres est le fossé qui sépare cette jeunesse bourgeoise des hommes qu’elle va fréquenter, aussi bien la troupe composée de la jeunesse populaire, essentiellement paysanne, que le groupe des officiers Les chefs sont responsables de la stupidité de l’organisation, donc eux-mêmes stupides ; les soldats ne se révoltent pas, ils sont donc lâches, ou stupides, ou les deux. La première réaction correspond à un choc.
Quand on aura dit que cette réaction est fondée sur la différence de classes, donc de statut économique et culturel, on n’aura fait qu’un constat. Au 18 è siècle la distance qui séparait Chateaubriand ou Talleyrand[2] des paysans incultes qui entouraient leurs châteaux était au moins aussi grande, sinon plus ; elle était connue, admise de tous, et ne suscitait aucune réaction d’étonnement ni de rejet ; elle était « naturelle » ; lorsqu’on était un chrétien riche et responsable on y répondait par la charité et, ayant fait, on n’y pensait plus car on avait fait son devoir.
De nos jours existe, parait-il, une culture de la jeunesse, fondée sur le partage des mêmes images, chansons, coutumes transmises par Internet et les « réseaux sociaux » auxquels, pratiquement, tous les jeunes ont accès, du moins dans le monde occidental. Ceux des villes ne rencontrent pas les banlieusards, ne fréquentent pas les mêmes lieux, ne profitent pas de la même éducation, quoi qu’en dise le mythe républicain ; mais ils ont accès aux mêmes réseaux, aux mêmes images et commentaires, ou absences de commentaires -, donc aux mêmes mythes. Et quand ils se rencontrent, s’ils se rencontrent, ils ont des sujets de conversation communs, ce qui leur permet de se croire semblables, même si c’est une croyance superficielle. Mais le creuset de l’égalité républicaine, le service militaire n’existe plus, les jeunes ne vivent plus nulle part ensemble et n’ont plus de longue expérience commune.
L’industrialisation des XIX et XX è siècles a exploité les classes ouvrières, ne s’est pas occupée de leur formation et a abandonné progressivement les campagnes ; bref la victoire de la démocratie bourgeoise a causé une rupture entre jeunesse des villes et jeunesse des champs ; en aout Olivier, Jacques, Pierre ou Jacqueline allaient pêcher les écrevisses dans les ruisseaux du Morvan, de l’Auvergne ou des Alpes, ils apprenaient les techniques ancestrales et se croyaient les égaux de ceux qui étaient alors leurs professeurs ; ils ne s’apercevaient pas qu’en dehors de ces jeux de l’été, ils ne savaient pas grand-chose sur les références morales de leurs amis, ou sur leurs réactions face aux problèmes de la vie, le plaisir, la souffrance, la violence ou la mort. L’armée allait leur faire prendre conscience de leur ignorance.
Les hommes :
Jacques, Pierre et Olivier se préparent à devenir officiers de réserve : ils vont avoir à commander ; mais à qui ?
« J’ai l’impression d’être tombé dans un guêpier. J’ai un travail monstre, pas une minute à moi. Et ce travail que je hais. 26 bonshommes, 2 ont leur certificat d’études, 2 sont illettrés, + 1 imbécile. Tous braves bougres, d’ailleurs. Tu ne peux te figurer le degré de culture de ces gens-là. Ah si ! c ‘est vrai : tu connais les paysans du massif central. Bon. Cela te donne une idée. Le malheur n’est pas là, il consiste à ce que j’ai à leur faire apprendre des conneries qui ne m’intéressent pas. Les pauvres, en plus, sont démoralisés, dépaysés, etc. J’ai pitié. Je n’ai pas honte. Ce serait inutile et un peu ridicule. On en arriverait à se suicider, à force de honte, si l’on cultivait un tant soit peu cette partie de sa sensibilité. Je ne fais pas l’instruction moi-même, je la fais faire par des gradés, ou bêtes, ou méchants (j’exagère), en tout cas aussi embêtés que moi et pas très futés. Je ne peux plus lire, je suis trop énervé, je bafouille moralement, j’ai des ennuis d’argent. C’est le premier jour, c’est TRRRragique ! » (Pierre, décembre 1952)
« Beaucoup de travail, une nouvelle bande de 34 gaziers, un peu plus abrutis, peut-être, que les précédents, mais très gentils. » (Pierre, hiver 1953)
Quant à Olivier, il est dans les transmissions, et commande donc des spécialistes formés ; ce qui ne les rend pas plus « intellectuels » :
« Mes camarades ne sont ni crottés, quoique notre tenue se réduise à un deux pièces, short et sandales, ni stupides. Bien sûr tu ne les trouverais pas hautement intellectuels, et tu les jugerais populaires. Mais c’est quand même la crème de la nation. (Considère toi comme l’ile flottante sur la crème…) surtout si on les compare aux soldats des autres armes de l’armée de terre (infanterie, artillerie, génie), qui sont tous des culs terreux. Les transmissions, tout orgueil de corps mis à part, sont une arme d’élite, et la V.H.F. est l’élite des Trans. En VHF il y a 35 % des individus qui ont le premier bac, les autres sortent en général d’une école professionnelle quelconque, niveau brevet. Il n’y a aucun illettré chez nous. » (Olivier, Mehdia, aout 1957)
Qu’ils soient plus ou moins « lettrés » ils n’en sont pas moins désemparés devant la vie qu’on leur propose mais ne réagissent pas. Car
– Ils respectent la hiérarchie
« Ici avec mes six mois je joue les anciens, surtout devant les bleus de la 57/2/A. Ce qu’un bleu peut être bête. Je l’ai été ; il est encore impressionné par les grades. » (Olivier, avril 1957)
– Ils n’ont pas les moyens physiques ou intellectuels de résister à la vie qu’on leur impose
« Être six mois dans un pays au climat rude où il n’y a strictement rien à faire, où pas un sourire féminin, fut-ce au plus bas dancing du dimanche, n’égaie la vie, où la seule compagnie est celle des hommes qui n’ont rien à faire d’autre de la journée qu’à subir, qui, en outre, sont affaiblis physiquement par une nourriture déficiente, et moralement par l’interdiction de toute volonté propre et de prise de responsabilité, etc. … » (Olivier, mai 1957)
Le constat est général : les recrues sont plutôt abrutis, peu portés sur les choses de l’esprit, révérencieux devant la hiérarchie, incapables moralement et physiquement de faire face à l « absurdité » militaire.
Entre 52 et 58 la situation ne change pas : : les soldats de base, d’où qu’ils viennent, ne peuvent, -ni ne veulent- prendre des initiatives. Nos héros n’en tirent pas de conclusions politiques, ils s’occupent d’eux-mêmes, ce qui est déjà assez difficile, et éventuellement aident les hommes dont ils ont la charge : cela s’arrête là.
Après le premier choc nait une volonté de comprendre
« Je suis très fatigué. Je m’aperçois avec étonnement que mes gaziers m’occupent beaucoup et m’intéressent. Il ne s’agit pas des imbécillités dont il faut leur bourrer le crâne, mais de la façon de le faire, de la façon dont ils réagissent en général. Je t’ai déjà parlé du degré de dénuement de ces pauvres gens. On ne peut s’empêcher de s’attacher à eux. Il faut les rassurer, les réveiller, essayer de chasser le cafard, écouter leurs petites histoires. Un ou deux l’ont déjà fait et c’est extraordinaire de sentir leur confiance. Il faudrait pouvoir se montrer à la hauteur, chaque fois que cela se présente… Ici je peux toucher l’absurde[3] du doigt, mais d’une façon bien plus éclatante, et bien plus tragique qu’avant. Voilà des garçons qui ne savent [pas] s’ils vivent sous la troisième ou la quatrième république, certains même ignorent le mot et son sens, aucun ne saurait dire ce qu’est l’assemblée nationale, etc… Cet exemple peut paraitre stupide, mais voilà des gens qui voteront plus tard pour le dernier politicien qui leur aura offert un verre de rouge en leur tapant sur l’épaule. Ils feront aussi la guerre sans savoir pourquoi (Il est vrai que dans ce cas je n’en saurai guère plus long qu’eux) Il ne s’agit pas évidemment de la totalité, mais la grande majorité de ces garçons est ainsi. » (Pierre, décembre 1952)
Et un désir de prendre en charge, d’aider
Chacun le fait à sa manière : des cours de langue
« Beaucoup de travail, une nouvelle bande de 34 gaziers, un peu plus abrutis, peut-être, que les précédents, mais très gentils. Je fais deux heures de cours de français par semaine : oh ! tout ce qu’il y a de plus élémentaire. (Pierre, hiver 1953)
: des moyens pas trop bêtes de passer le temps
« Nous voguons ensemble sur la lande de Mehdia, nous distrayant à de menus jeux : pétanque, belotte, poker, [un mot illisible], dames, et échecs. Vois là l’intelligence de mes premiers zèbres : je leur ai appris à jouer aux échecs en moins de 2 heures. Maintenant ils sont fanatiques. » (Olivier, Mehdia, aout 1957)
L’encadrement
Les années 50 sont une période intermédiaire : on fait du « maintien de l’ordre » et non « la guerre » ; on « rappelle » le contingent, on ne mobilise pas ; on se bat contre des gens qui demandent une liberté dont nous jouissons nous-mêmes, non contre des ennemis qui menacent la nôtre. Bref l’armée d’Afrique du nord n’est pas une armée en guerre ; elle l’est de fait mais ne peut s’en réclamer. Le soutien patriotique unitaire n’existe pas, qui a fait, 20 ans auparavant, l’union contre la menace vitale du fascisme. Les pères de nos jeunes gens pourtant ne croyaient guère à l’action militaire : ils sont partis sans fleurs au fusil ni crier « à Berlin », mais sont partis quand même. Leurs fils ne savent pas trop ce qu’ils défendent, et certainement pas un régime politique qu’ils méprisent : ils ne sont donc pas prêts à accepter le modèle de l’armée telle qu’elle est, au nom de l’intérêt supérieur de la nation.
Les jeunes bourgeois des années 50 ont des officiers une idée simplette, fondée sur l’histoire dont leurs familles ont été victimes et l’imagerie qu’elles ont transmise. Un : les généraux ont perdu deux guerres mondiales, causé deux massacres effroyables et viennent de perdre la guerre d’Indochine. Deux : la classe militaire qu’ils connaissent, via la littérature,[4] est celle de Courteline, et celle aussi dont Clemenceau disait que la guerre est une chose trop sérieuse pour la confier aux militaires. Résumé : incompétence et ridicule. Ce qu’ils verront pendant leur service aura du mal à les faire changer d’avis.
Pour eux, les officiers n’ont pas souci des hommes dont ils ont la charge, n’observent aucune des consignes qu’ils imposent et s’occupent surtout de leurs intérêts personnels :
« Les ¾ de ces bonshommes [les nouvelles recrues] devraient être exemptés de tout effort physique. Mais « il faut » marcher, parait-il… J’ai particulièrement gouté la façon élégante qu’ont les gradés de se désintéresser des éclopés, affalés sur la piste à 2 kms du but. » Pierre, Souk el Arba, printemps 1953
« Je t’écris 10 minutes avant l’appel du soir – 9 heures. Moment de suspense répété chaque jour, mais accentué selon le chef d’appel. Hier le chef nous a donné un aperçu de ce que serait aujourd’hui. Il entre comme un rocket, saoul, déclare : « C’est le bordel là-dedans, la 1ère Cie, c’est le souk, pas de discipline, j’vous foutrai tous dedans, mes gaillards. Maniement d’armes à deux heures du matin. Ah ! Ah ! Ah ! » Sortie. Hi, hi, hi, qu’on fait, puis Rrr, Rrr, Rrr.
Ce soir on va recommencer. Sera-ce la poussière du nième ressort, le clou qui manque à mes chaussures, la tache sur le casque, mais je sens que je serai pris. Merveille de la discipline ! Tout autre dans cette certitude ne ferait rien, le soldat, lui, fait tout ce qu’il peut, sachant qu’il sera pris quand même. En 6 mois on se moule sur un modèle type, normalisé, et dûment hiérarchisé.
Tout cela parait ridicule, mais quand le barème est de huit jours de consigne cela fait réfléchir. » Olivier, Fès, 1957
« Si j’ai bien compris un futur officier doit être froid, distant, traiter l’homme de troupe comme du bétail et, oubliant toute amitié, ne se soumettre qu’à un Dieu strict et inhumain, la Discipline. » Olivier, Fès, 1957
Il y a, Dieu merci, des exceptions : Olivier rencontrera des chefs qui l’aideront à sortir de la situation difficile dans laquelle il s’est mis ; Pierre trouvera même un ami, à son grand étonnement :
« Événement extraordinaire : il est arrivé ici un type, un officier (!), avec qui je puis discuter, et avec plaisir. Il a passé deux ans en poste à Madagascar, à créer des rizières, des postes sanitaires, des écoles, des plantations. Ici il s’embête autant que moi. Idées saines, réactions saines. En guise de coup de sonde, lui ai fait lire un numéro d’Esprit sur les histoires de Casa et le colonialisme. En gros il est d’accord. Ni pourri, ni abruti. J’en suis encore tout étonné… » Pierre, Souk el Arba, hiver 1952/53
Comme d’habitude, les exceptions confirment la règle.
II
Le deuxième constat concerne l’archaïsme des installations et de l’organisation : comment peut-on prétendre mener des opérations militaires avec un minimum de chances de réussir, en partant d’infrastructures aussi insuffisantes ? Nos jeunes gens sont de futurs cadres des grandes entreprises, publiques ou privées [5]. La gestion des organisations est au centre de leurs préoccupations ; et celle de l’armée leur parait catastrophique.
Saleté et inconfort
Pour nos futurs cadres, si l’on veut que les employés soient rentables, il faut commencer par leur assurer des conditions matérielles correctes. Or c’est loin d’être le cas.
« Istres à première vue ne semble pas très folichon. … La Base est sale, encore à l’état de tas de cailloux et de bâtiments camouflés. » Jacques 1952
« La pluie, pour nous, tu vois c’est une véritable obsession. En effet toute notre vie était axée sur la vie en plein air – lavabo, évier, W. C. dans la nature (Je te laisse à penser comment l’usage du dernier est agréable sous l’orage, tandis que l’on peut toujours différer l’usage des deux premiers). Le réfectoire est une paillote, les groupes électrogènes sont en plein air et se noient à qui mieux mieux, nécessitant des démarrages sous des cataractes. Ce qui fait que nous vivons entièrement et uniquement dans la petite chambre commune où nous mangeons, dormons, lisons, écrivons en compagnie des deux chiens. C’est donc un retour à la vie primitive des paysans en hiver. » Olivier, Mehdia, nov. 1957
« [Les] privilèges qu’ont toujours donné [la] famille, la Rrrépublique, le Kapitalisme » (Pierre, sic) leur ont permis d’échapper à ces conditions de vie « primitives », ils en sont conscients, peuvent donc le supporter et, dans l’incapacité où ils sont d’y porter remède, finissent par le faire, via la débrouillardise et à l’humour. La première réaction n’en est pas moins la révolte … et le dégout.
Absurdité du système : « secret militaire »
L’inconfort, l’impréparation des structures d’accueil, cela peut s’expliquer, et être surmonté. La désorganisation, non, surtout lorsqu’elle est inutile. Un détail, particulièrement risible, souligne pour eux la bêtise du système : le « secret militaire ». Les « rappelés » du maintien de l’ordre, troupe « guerrière » installée au milieu d’une vie civile qui reste ordinaire puisque c’est elle qu’ils défendent, le découvrent avec humour :
Jacques :
Correspondance aux armées : Partie réservée à la correspondance
« Bobonne
Je vais bien. La nourriture est bonne. Les chefs sont gentils. J’espère que tu vas bien. Nous sommes arrivés à X…, le 18 septembre 1903. Vive la France » Jacques septembre 1953
Olivier
« Uranus, le 12/09/1957 : « Je t’écris tout en luttant contre l’envahissement du sable, pour te signaler mon n nième chgt d’adresse. Cependant je n’ai pas déménagé mais l’ancienne adresse te signalait des faits militaires importants, et strictement secrets. C’est-à-dire qu’au lieu-dit X.… se trouve la station VHF Uranus, dont les antennes sont visibles dans un rayon de 30 kms et que pas un bougnoul de la province n’ignore, et qu’au camp de M. … se trouve un camp militaire très important, où la population européenne de Casablanca vient assister au défilé du 14 juillet. Tout cela dans le plus strict secret bien entendu » Olivier, Mehdia, sept 1957
Bien ! S’il n’y avait que cela on pourrait se contenter d’en rire. Mais d’autres découvertes sont plus insupportables. Ces jeunes gens sont là pour faire un certain travail, et, même s’ils ne l’ont pas demandé, ou s’ils en jugent les objectifs discutables, voire inaccessibles, leur éducation tant morale que pratique les pousse à le faire correctement, puisqu’ils sont là pour le faire. Or on ne travaille ni correctement ni suffisamment.
Inorganisation du travail, imprévisibilité -> dégout
« Sitôt débarqué à la Base je me suis fait harponner par le Pitaine. « Pstt ! Hé là-bas vous ne faites rien, je crois ? » Et depuis je travaille. Oh bien sûr, de la façon militaire : c’est-à-dire 2 ou 3 heures par jour… » Jacques, 1952
« Quant au travail, … le lit accapare la plupart du temps. » Olivier, Mehdia le 06/09/1957
Pourquoi enlever des jeunes gens aux tâches civiles à quoi ils se sont préparés si c’est pour ne rien leur faire faire ?
L’organisation est toujours imposée, jamais expliquée dans ses objectifs et son schéma général ; elle parait ne s’attaquer qu’à des points de détail, donc semble « absurde » (sic) et n’avoir pour but que d’« embêter » (sic) les gens. On ne peut ni l’améliorer, ni y échapper, sinon dans une inaction encore plus insupportable
« Les récits des gens qui viennent des corps de troupe vous font tout de suite penser à un asile de fous… » Pierre, arrivée à St Maixent, 1952, (école d’E.O.R.)
« Je retrouve le gout amer des débuts de semaine, et cette agaçante question : qu’est-ce qu’ils vont bien inventer pour nous embêter cette semaine ?… Pierre, Souk el Arba, été 1953
« Une permission se réduit au plaisir d’échapper pour vingt-quatre ou quarante-huit heures à la bêtise ambiante, mais pour se réfugier dans l’inaction. On a pieds et poings liés. » Pierre, St Maixent, 1952, début du séjour
« La déconfiture est totale. La connaissance de toute cette saloperie est achevée, parachevée, fignolée, etc. Nous retrouvons, Nicolas (!) et moi, le même dégout qu’au mois de Mai ou de Juin ». Pierre, St Maixent, fin de la formation d’E.O.R., juillet 1952
Pierre, l’artiste, en vient à se demander si tout cela n’est pas « organisé » pour heurter, donc détruire, sa sensibilité ! Le but est-il de formater des gens qui n’auront plus d’autre initiative que celles qui cadrent avec les objectifs de l’armée ?
« Peut-être est-ce cette vie d’attente et de défense soigneusement organisée qui me rend tellement sensible… » Pierre, Souk el Arba, été 1953
Il n’est pas très loin de comprendre, ce qui ne veut pas dire qu’il accepte. Encore une fois il ne pourrait accepter, comme ses père et grands-pères ont pu le faire, que pour un objectif plus haut que celui qu’il a fini par saisir : défendre la « civilisation occidentale » et la colonisation. Jacques et Olivier sont moins radicaux, ce qu’ils refusent ce n’est pas la colonisation en soi, c’est la façon dont elle est menée dans le mépris du « bougnoul » (ou du « niaqué ») et par un personnel politique incapable et corrompu, ce qui la condamne à l’insuccès : voir Dien Bien Phu.
Dans ces conditions pourquoi devenir officier et, donc, être coresponsable de l’absurdité ? Tous trois ont, à un moment ou à un autre, et pour des raisons personnelles différentes, songé à démissionner et à finir leur « service » comme homme de troupe.
[1] Le mot « absurde » est celui qui vient le plus fréquemment et le plus naturellement sous leur plume pour qualifier les situations militaires dans lesquelles ils sont, malgré eux, plongés.
[2] Voir leurs Mémoires. La classe paysanne représente 80 % de la population à l’époque.
[3] C’est moi qui souligne
[4] Aucun des trois n’a de militaire dans sa famille
[5] Jacques sera ingénieur chez Michelin à Clermont Ferrand, Pierre se destinait au théâtre, comme acteur et metteur en scène, ce que sa mort précoce empêcha, Olivier sera responsable des grands anneaux du CERN à Genève.















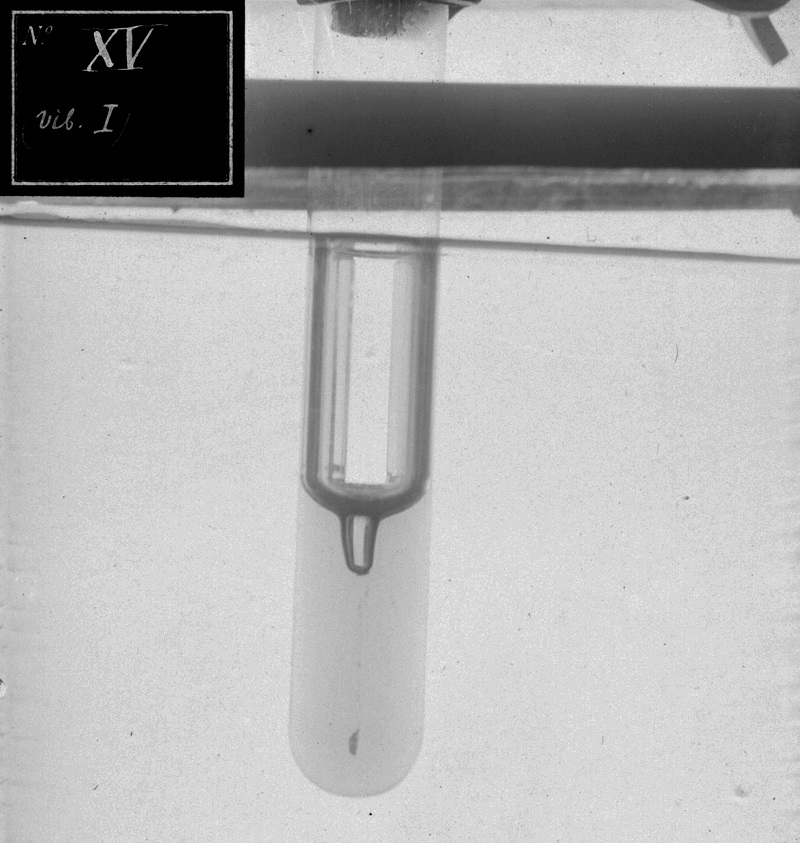






 portrait studio Harcourt
portrait studio Harcourt

